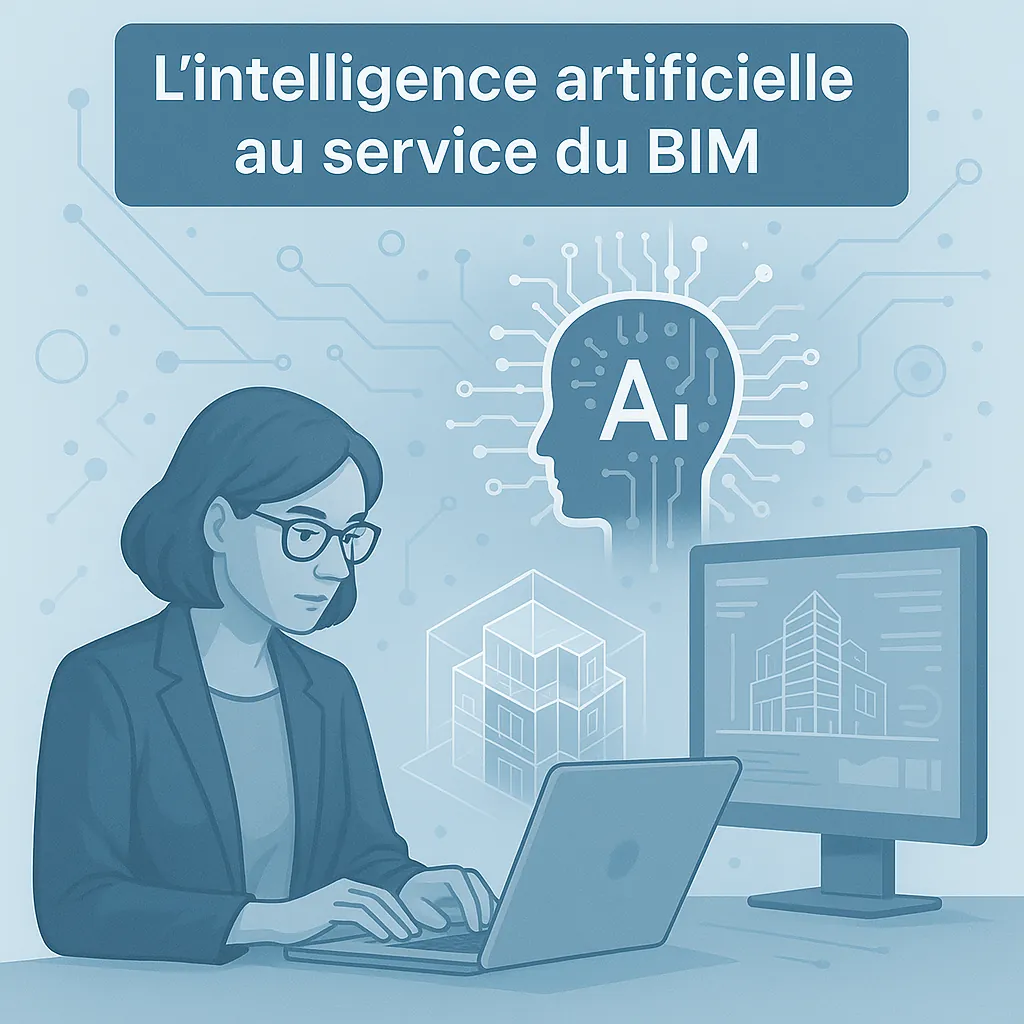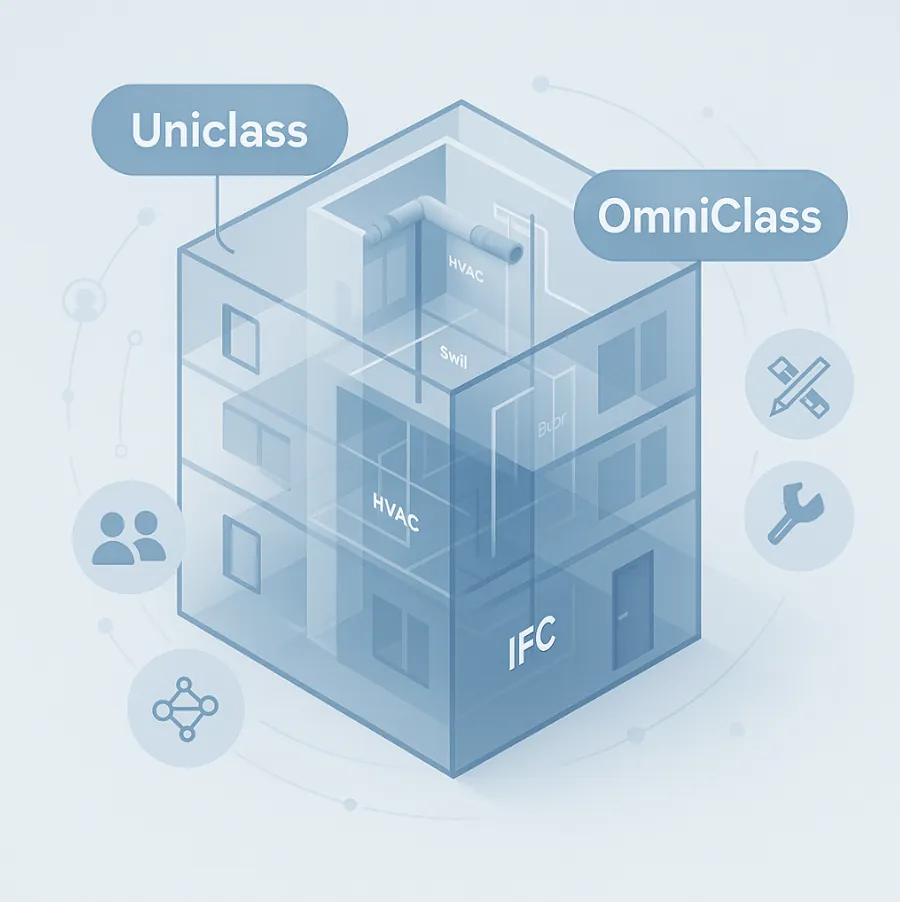Une méthode en pleine progression, mais encore inégalement adoptée :
Le BIM, longtemps perçu comme une innovation réservée aux grands groupes du BTP, s’impose progressivement en France comme une méthode de travail incontournable. Pourtant, malgré ses nombreux atouts, son adoption reste encore inégale et parfois hésitante.
En 2025, environ 42 % des agences d’architecture françaises utilisent le BIM, mais seulement 12 % atteignent le niveau 2, impliquant une collaboration structurée et partagée entre tous les acteurs d’un projet (Le Moniteur, 2024). Cette modélisation collaborative reste marginale, surtout dans les petites structures. Seules 13 % des entreprises de moins de 10 salariés ont intégré le BIM à leurs pratiques, contre 72 % des entreprises de plus de 50 salariés (Le Moniteur, 2024).
Les freins à l’adoption ( coûts, compétences et inertie) :
L’un des principaux obstacles à l’adoption du BIM reste son coût d’entrée élevé. L’acquisition de logiciels (comme Revit, Archicad ou Allplan), les équipements adaptés et la formation représentent un investissement moyen estimé entre 8 000 € et 15 000 € par poste (Rapport du 117e Congrès des Notaires de France, 2021).
S’y ajoutent des difficultés de montée en compétences. Selon Le Moniteur (2024), 43 % des professionnels évoquent un temps d’apprentissage trop long, tandis que 39 % pointent un manque de formation initiale adaptée.
À cela s’ajoute une résistance culturelle. Beaucoup de professionnels restent attachés à des pratiques traditionnelles : plans 2D, fichiers PDF, échanges séquentiels. Cette inertie freine l’adoption d’outils collaboratifs. Même si près de 80 % des professionnels connaissent le format IFC (Industry Foundation Classes), 38 % d’entre eux déclarent rencontrer des problèmes d’interopérabilité entre les différents logiciels (Cahiers Techniques du Bâtiment, 2023).
Des bénéfices pourtant bien réels :
Malgré ces obstacles, les avantages du BIM sont indiscutables. Le Congrès des Notaires estime qu’une adoption généralisée du BIM en Europe pourrait générer jusqu’à 130 milliards d’euros d’économies, soit 10 % du marché de la construction. En France, certains projets témoignent de gains de productivité allant de 2 % à 18 %, selon les cas (Rapport du 117e Congrès des Notaires, 2021).
Des expérimentations concrètes en région
Plusieurs initiatives locales démontrent la pertinence du BIM à l’échelle territoriale. Dans la Région Grand Est, une charte BIM régionale a été instaurée pour structurer la numérisation du patrimoine immobilier public. Grâce à des maquettes numériques enrichies, la maintenance des bâtiments est aujourd’hui pilotée de manière centralisée (Cooperlink, 2024).
À Monaco, un projet ambitieux vise à modéliser plus de 1 500 bâtiments, afin de centraliser la gestion du territoire dans un environnement numérique complet (Cooperlink, « 10 years of BIM – where are we now? », 2024).
Un soutien public qui doit aller plus loin :
Pour accompagner cette transition, plusieurs dispositifs ont été mis en place. Le Plan BIM 2022, financé à hauteur de 20 millions d’euros, a permis de promouvoir des outils comme KROQI (la plateforme collaborative du CSTB) et de valoriser les formats ouverts tels que l’IFC (Observatoire du Plan BIM, 2022).
Des aides financières, nationales ou régionales, peuvent également soutenir l’investissement : jusqu’à 30 % des équipements informatiques et 25 % pour les logiciels peuvent être couverts (Le Moniteur, 2022).
Un changement de culture plus qu’un changement d’outils :
Mais au-delà de la technologie, le BIM appelle un changement de méthode et de culture. Il repose sur une logique de collaboration précoce et de partage en temps réel des données. Cela remet en cause l’organisation séquentielle traditionnelle des projets et nécessite une nouvelle posture : faire confiance, partager, intégrer les autres acteurs dès les premières phases.
Le niveau de maturité BIM reste très variable. Beaucoup de projets restent au niveau 1 (modèles séparés, sans collaboration structurée). Le niveau 2, basé sur des modèles partagés (souvent au format IFC), est encore loin d’être la norme. Et lorsqu’il est mis en œuvre, il reste souvent cantonné à des usages visuels, sans aller jusqu’à la détection de conflits ou à la planification numérique.
Le BIM GEM, un potentiel encore sous-exploité :
Le BIM GEM (pour Gestion, Exploitation, Maintenance), reste aujourd’hui marginal. Pourtant, il représente un levier majeur pour optimiser la durée de vie des bâtiments, en particulier dans le secteur public. Moins de 10 % des maîtres d’ouvrage publics disposent d’un protocole BIM GEM structuré (Observatoire du Plan BIM, 2022). C’est pourtant à ce stade que la donnée devient la plus précieuse pour assurer une maintenance préventive, anticiper les travaux et centraliser la gestion patrimoniale.
Conclusion :
Aujourd’hui, il ne fait plus de doute que le BIM est une clé de voûte de la transition numérique et environnementale du bâtiment. Pour que la France rattrape son retard, il est impératif :
- d’investir massivement dans la formation continue et initiale,
- de soutenir l’accès des TPE et PME aux outils BIM,
- et de généraliser des standards ouverts et interopérables.
Le BIM ne doit plus être l’apanage des grandes structures, mais devenir un langage partagé par l’ensemble de la filière, au service de la qualité, de la durabilité et de l’intelligence collective dans la construction.
Sources
Le Moniteur, 2024 – L’adoption du BIM, un processus lent mais indéniable
Rapport du 117e Congrès des Notaires de France, 2021 – Le BIM en France
Cooperlink, 2024 – 10 years of BIM – where are we now?
Cahiers Techniques du Bâtiment, 2023 – Les enjeux du BIM en France
Observatoire du Plan BIM, 2022 – État des lieux et dispositifs publics